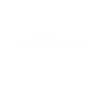École
Formations
Campus
Admission
Carrières
Entreprises
Développement durable des territoires : les enjeux de la gestion de projets culture-tourisme
04.08.2025
Le tourisme culturel traverse une période de profonde transformation, principalement influencée par l’évolution rapide des attentes des visiteurs, à la recherche d’expériences immersives et authentiques. Face à ces nouvelles attentes, les territoires ruraux, riches d’un patrimoine encore souvent sous-exploité, perçoivent une opportunité majeure de développement. Toutefois, ces initiatives requièrent une gestion très structurée pour surmonter des obstacles multiples. Andréas Desvignes, chargé de mission en ingénierie culturelle à Oise Tourisme revient sur les principaux défis que doivent relever ces territoires.
Le tourisme culturel connaît un regain d’intérêt, notamment en réponse à une demande croissante d’authenticité, de patrimoine et de lien avec l’histoire locale. Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des identités régionales et de développement durable. Les territoires ruraux, longtemps marginalisés dans les grandes politiques touristiques, apparaissent aujourd’hui comme des espaces à fort potentiel. Ils offrent un patrimoine matériel et immatériel riche, souvent sous-exploité, qui peut devenir un levier puissant de revitalisation économique, sociale et culturelle (ANCT, 2023) Cependant, pour saisir pleinement ces opportunités, les porteurs de projets locaux se heurtent à de nombreuses difficultés. Pour Andréas Desvignes, ces difficultés « peuvent survenir à toutes les étapes du projet : de sa conception initiale à sa mise en œuvre, voire à la phase de maturité du produit mis en marché. ». Selon lui, l’ingénierie financière complexe et les défis liés à la réglementation figurent parmi les obstacles majeurs que rencontrent les porteurs de projets.
Le tourisme culturel connaît un regain d’intérêt, notamment en réponse à une demande croissante d’authenticité, de patrimoine et de lien avec l’histoire locale. Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des identités régionales et de développement durable. Les territoires ruraux, longtemps marginalisés dans les grandes politiques touristiques, apparaissent aujourd’hui comme des espaces à fort potentiel. Ils offrent un patrimoine matériel et immatériel riche, souvent sous-exploité, qui peut devenir un levier puissant de revitalisation économique, sociale et culturelle (ANCT, 2023) Cependant, pour saisir pleinement ces opportunités, les porteurs de projets locaux se heurtent à de nombreuses difficultés. Pour Andréas Desvignes, ces difficultés « peuvent survenir à toutes les étapes du projet : de sa conception initiale à sa mise en œuvre, voire à la phase de maturité du produit mis en marché. ». Selon lui, l’ingénierie financière complexe et les défis liés à la réglementation figurent parmi les obstacles majeurs que rencontrent les porteurs de projets.
Maîtriser l’ingénierie financière et réglementaire
La gestion financière des projets culturels est souvent complexe « en raison de la diversité des sources de financement qui implique un travail conséquent de formalisation et de suivi », explique Andréas Desvignes. Les fonds proviennent généralement d’entités publiques, du mécénat privé et de ressources propres, ce qui nécessite une gestion particulièrement structurée et précise. Cependant, les collectivités locales, essentielles dans la mise en œuvre de projets de développement, manquent parfois des compétences nécessaires pour naviguer dans les complexités des aides d'État et des fonds européens (Sénat, 2019).
Aussi, les contraintes réglementaires, notamment liées à la sécurité ou à la protection du patrimoine, constituent également un frein important. « Ces réglementations mobilisent des compétences spécifiques et alourdissent les démarches administratives », ajoute-t-il. Une méthodologie solide fondée sur un diagnostic précis et une structuration claire des étapes du projet est donc indispensable.
Aussi, les contraintes réglementaires, notamment liées à la sécurité ou à la protection du patrimoine, constituent également un frein important. « Ces réglementations mobilisent des compétences spécifiques et alourdissent les démarches administratives », ajoute-t-il. Une méthodologie solide fondée sur un diagnostic précis et une structuration claire des étapes du projet est donc indispensable.
Favoriser une gouvernance partagée et collaborative
L’un des enjeux majeurs du développement touristique réside dans la capacité à fédérer une diversité d’acteurs locaux, institutionnels et privés. D'après les observations d'Andréas Desvignes, « la coordination d’acteurs aux intérêts et expertises hétérogènes exige la mise en place d’une gouvernance partagée et d’un pilotage clair ». Cette remarque met en lumière une réalité fréquemment observée sur le terrain : les projets touristiques échouent souvent non par manque d’idées ou de ressources, mais en raison de la difficulté à créer une dynamique collective cohérente. Notamment en milieu rural, où les ressources humaines et techniques peuvent être limitées, la gouvernance partagée apparaît non seulement comme une nécessité organisationnelle, mais aussi comme une condition de réussite durable. Elle permet de dépasser les logiques sectorielles, d’articuler les compétences complémentaires des parties prenantes et d’assurer une vision commune du projet, souvent indispensable à son acceptation locale et à sa viabilité économique.
Renforcer l’innovation en associant culture et tourisme
Le rapprochement entre les secteurs culturel et touristique est un autre enjeu important, mais souvent négligé. Les objectifs de ces deux secteurs sont souvent différents, ce qui rend leur collaboration complexe. Comme le souligne Andréas Desvignes, « le tourisme conceptualise un produit basé sur l’expérience visiteur et l’attractivité, tandis que la culture se concentre sur la transmission historique et la conservation ». Cette différence de perspective peut rendre difficile la création de projets communs, car le tourisme cherche à séduire un large public avec des expériences immersives, tandis que la culture met l’accent sur la préservation de l’héritage et la transmission de savoirs.
Cependant, en rapprochant ces deux domaines, il est possible de créer des expériences enrichissantes qui à la fois respectent et valorisent le patrimoine tout en attirant de nouveaux visiteurs. Une telle approche peut non seulement stimuler l’économie locale, mais aussi favoriser une meilleure compréhension et un plus grand respect des richesses culturelles.
Cependant, en rapprochant ces deux domaines, il est possible de créer des expériences enrichissantes qui à la fois respectent et valorisent le patrimoine tout en attirant de nouveaux visiteurs. Une telle approche peut non seulement stimuler l’économie locale, mais aussi favoriser une meilleure compréhension et un plus grand respect des richesses culturelles.
Andreas Desvignes illustre ce rapprochement Culture – tourisme avec l’exemple de L’abbaye cistercienne Notre-Dame d’Ourscamp, classée au titre des Monuments Historiques et située à Chiry-Ourscamp dans l’Oise :
« L’abbaye a bénéficié de l’accompagnement de Oise Tourisme afin de répondre à la volonté des moines - propriétaires des lieux - d’attirer davantage de visiteurs, notamment des familles, des promeneurs de passage et des étrangers, et de favoriser leur retour. Pour cela, un dispositif touristique immersif et interactif a été conçu, permettant une découverte autonome de ce haut-lieu historique. Une application mobile téléchargeable propose deux parcours de visite, enrichis de panneaux d’information disposés sur le site. Ces panneaux permettent de déclencher, via l’application, des scènes en réalité augmentée.
Le premier parcours est ludique et ponctué de jeux et d’énigmes accessibles à tous, agrémentés de reconstitutions 3D du bâti et d’un guide virtuel doté d’une voix. Le second prend la forme d’un jeu d’enquête de type Cluedo, conçu pour être rejouable grâce à la recomposition aléatoire des indices et de la solution à chaque nouvelle partie. Ce projet, réalisé sur une année entière, a mobilisé de nombreux acteurs des secteurs culturel, patrimonial et touristique qui ont œuvré collectivement à la sélection, l’adaptation et la valorisation de contenu intégrés au sein de l’application et accessible pour tous les publics.
Pour mener à bien ce projet, de nombreux financeurs ont été sollicités, subventionneurs publiques et mécènes ».
« L’abbaye a bénéficié de l’accompagnement de Oise Tourisme afin de répondre à la volonté des moines - propriétaires des lieux - d’attirer davantage de visiteurs, notamment des familles, des promeneurs de passage et des étrangers, et de favoriser leur retour. Pour cela, un dispositif touristique immersif et interactif a été conçu, permettant une découverte autonome de ce haut-lieu historique. Une application mobile téléchargeable propose deux parcours de visite, enrichis de panneaux d’information disposés sur le site. Ces panneaux permettent de déclencher, via l’application, des scènes en réalité augmentée.
Le premier parcours est ludique et ponctué de jeux et d’énigmes accessibles à tous, agrémentés de reconstitutions 3D du bâti et d’un guide virtuel doté d’une voix. Le second prend la forme d’un jeu d’enquête de type Cluedo, conçu pour être rejouable grâce à la recomposition aléatoire des indices et de la solution à chaque nouvelle partie. Ce projet, réalisé sur une année entière, a mobilisé de nombreux acteurs des secteurs culturel, patrimonial et touristique qui ont œuvré collectivement à la sélection, l’adaptation et la valorisation de contenu intégrés au sein de l’application et accessible pour tous les publics.
Pour mener à bien ce projet, de nombreux financeurs ont été sollicités, subventionneurs publiques et mécènes ».
Le numérique au service de l’attractivité
Le numérique est un outil puissant pour rendre les sites culturels plus attractifs, mais il doit être bien intégré aux projets. Selon Andréas Desvignes, il est important de proposer des dispositifs simples et faciles à utiliser : « le visiteur ne doit ni saisir de longues informations ni installer une application lourde ». Cela permet de rendre l’expérience agréable et accessible à tous. Pour lui, les technologies immersives, comme la réalité virtuelle ou les visites interactives, sont très efficaces pour attirer de nouveaux publics, notamment les jeunes adultes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les sites culturels. Ces expériences permettent de rendre la culture plus ludique et engageante pour « renouveler les formats de visite sans dénaturer les lieux », et peuvent ainsi contribuer à élargir l’audience des lieux patrimoniaux.
Assurer la viabilité économique à long terme
Pour garantir la pérennité des projets culturels, Andréas Desvignes insiste sur l'importance de diversifier les sources de revenus. Il explique que « de nombreux sites augmentent leurs recettes propres en développant des boutiques, des cafés ou en louant des espaces pour des événements privés ». Cette stratégie permet aux sites culturels de ne pas dépendre uniquement des subventions publiques et d’assurer un financement plus stable.
Enfin, Andréas Desvignes identifie dans le tourisme de savoir-faire, une belle opportunité pour les entreprises. En effet, « ces entreprises peuvent voir une augmentation de leur chiffre d’affaires généré en organisant des visites de leur atelier auprès des visiteurs friands de découvrir les processus de réalisation de produits locaux et artisanaux. Une démarche qui explique, rassure et fidélise et qui peut inciter à l’achat ». Cette diversification des revenus permet non seulement de renforcer la viabilité économique des projets culturels, mais elle crée aussi des retombées positives pour les communautés locales, en favorisant l’emploi et en soutenant l’économie locale de manière durable.
Pour conclure et afin de concrétiser les opportunités offertes par le tourisme culturel dans les espaces, il est essentiel de mettre en place une véritable ingénierie touristique capable de structurer l’offre, de fédérer les acteurs locaux et de répondre aux attentes des visiteurs. Ce processus complexe suppose un accompagnement adapté notamment par les chargés de mission en ingénierie culturelle présents à différentes échelles institutionnelles, comme ici à Oise Tourisme. Grâce à une approche méthodique, il facilite l'intégration des enjeux financiers, réglementaires et numériques, tout en assurant une gestion fluide et adaptée des ressources. Ce partenariat renforce l'attractivité des destinations et favorise la pérennité des projets.
Enfin, Andréas Desvignes identifie dans le tourisme de savoir-faire, une belle opportunité pour les entreprises. En effet, « ces entreprises peuvent voir une augmentation de leur chiffre d’affaires généré en organisant des visites de leur atelier auprès des visiteurs friands de découvrir les processus de réalisation de produits locaux et artisanaux. Une démarche qui explique, rassure et fidélise et qui peut inciter à l’achat ». Cette diversification des revenus permet non seulement de renforcer la viabilité économique des projets culturels, mais elle crée aussi des retombées positives pour les communautés locales, en favorisant l’emploi et en soutenant l’économie locale de manière durable.
Pour conclure et afin de concrétiser les opportunités offertes par le tourisme culturel dans les espaces, il est essentiel de mettre en place une véritable ingénierie touristique capable de structurer l’offre, de fédérer les acteurs locaux et de répondre aux attentes des visiteurs. Ce processus complexe suppose un accompagnement adapté notamment par les chargés de mission en ingénierie culturelle présents à différentes échelles institutionnelles, comme ici à Oise Tourisme. Grâce à une approche méthodique, il facilite l'intégration des enjeux financiers, réglementaires et numériques, tout en assurant une gestion fluide et adaptée des ressources. Ce partenariat renforce l'attractivité des destinations et favorise la pérennité des projets.
Références :
Sénat. (2019). Rapport d'information n° 251 (2018-2019) : La revitalisation des centres-villes et centres-bourgs : une urgence pour les territoires (Rapport d'information). Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. https://www.senat.fr/rap/r19-251/r19-25110.html
Agence nationale de la cohésion des territoires. (2023, février). Étude sur la diversité des ruralités : Typologies et trajectoires des territoires. https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/etude-sur-la-diversite-des-ruralites-typologies-et-trajectoires-des-territoires-1057
Agence nationale de la cohésion des territoires. (2023, février). Étude sur la diversité des ruralités : Typologies et trajectoires des territoires. https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/etude-sur-la-diversite-des-ruralites-typologies-et-trajectoires-des-territoires-1057
À LIRE AUSSI SUR LE BLOG DE L'IEFT
École
Formations
Campus
Admission
Carrières