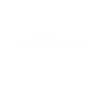L’heure est au revenge travel 👿
Le revenge travel, c’est quoi ?
Car oui, après deux ans à ne pas (ou peu) pouvoir voyager, les amoureux de découverte saturent des reportages et des vidéos (en VR ou pas) visualisés depuis leur salon pour une pseudo-évasion. C’est là qu’une envie irrésistible, voire une frénésie, les frappe de plein fouet. C’est décidé, une fois les choses possibles, le voyage sera leur priorité !
Le fameux revenge travel, ou « voyage de vengeance », apparaît sur les lèvres. Ce concept inventé par McKinsey & Company parle des « touristes qui ont cherché à se reconnecter, à explorer de nouvelles destinations ou à retourner dans leurs spots favoris, après avoir été contraints d'annuler, d'abandonner ou de modifier radicalement leurs projets de voyage », explique la directrice associée Aurélia Bettati.
Et le phénomène prend de l’ampleur dès la levée progressive des restrictions. Rattraper le temps perdu devient un mantra 🙏. Les vacanciers veulent retrouver leur liberté. Ils veulent consacrer leurs économies à découvrir, se faire plaisir, vivre. Ils veulent profiter. Ils veulent voyager plus. Voyager mieux.
Et comme tous les goûts sont dans la nature, le revenge travel s’applique aussi bien pour :
- Partir au bout du monde sur une plage de sable fin 🏖️ ;
- Voyager de manière plus authentique ;
- Prendre soin de soi lors d’un séjour bien-être 💆 ;
- Revisiter son spot préféré ;
- Rejoindre sa famille ou ses amis à quelques kilomètres de chez soi 👪…
Le revenge travel, un concept qui perdure
Les voyageurs sont devenus plus conscients de la valeur du temps et de la liberté. Ils apprécient davantage chaque moment passé à explorer le monde et à partager des instants avec leurs proches.
Parallèlement, la prise de conscience environnementale pousse à réfléchir à la manière dont nous voyageons. D’ailleurs, une autre tendance émerge : celle du tourisme de la dernière chance, motivé par l’urgence de découvrir des sites menacés 🥺. Les voyageurs cherchent non seulement à immortaliser ces lieux uniques, mais aussi à témoigner de leur beauté avant leur disparition. Ce tourisme devient une forme d’hommage, mais il appelle également à une réflexion sur notre rôle dans la préservation de ces sites.
Mais attention : après une boulimie de voyages, le concept se transforme en une quête de voyages plus significatifs. Les voyageurs ne cherchent plus seulement à cocher des destinations sur une liste, mais à vivre des expériences authentiques et enrichissantes.
Les professionnels ont alors développé leurs offres pour répondre à toutes les envies des voyageurs dont les besoins ont évolué vers un tourisme :
- Plus responsable ;
- De proximité ;
- De bien-être ;
- Expérientiel.
Le revenge travel, c’est pour qui ?
Les professionnels ont rapidement constaté que si les millennials ont été dans les starting-blocks, passeport en poche, d’autres profils ont rapidement rejoint le mouvement du revenge travel. Comme par exemple les séniors, qui ont pris conscience qu’ils n’ont pas de temps à perdre, ou encore les professionnels qui se tournent de plus en plus, pour les voyages d’entreprise, vers des destinations lointaines selon Interface Tourisme (Asie, océan Pacifique, Amérique du Sud, États-Unis…).
Et les pros, ils en pensent quoi 🙄 ?
Réponse collective : oui, oui, oui ! On commence par une étude de Kayak.fr qui dévoile une importante augmentation cet été des recherches de vols (+46 %) et des recherches d’hôtels (+59 %) par rapport à l’été 2022. Et cela concerne plusieurs régions du monde, de l’Europe à l’Amérique du Nord, en passant par l’Afrique et l’Asie. D’après le comparateur de voyages, « malgré la situation économique difficile, de nombreux voyageurs français semblent vouloir voyager à l'étranger et explorer de nouvelles destinations, comme Tokyo, dont les recherches de vols ont triplé (environ +256 %) ». On est ici en pleine démonstration de la volonté croissante des touristes à découvrir et explorer de nouvelles cultures ou vivre de nouvelles expériences.
Autre analyse (cette fois de Booking.com et Statista) : l’hébergement européen, avec un focus sur les hôteliers français qui ont ressenti sur l’ensemble du territoire les retombées du revenge travel. Il faut dire que la saison estivale a été particulièrement réussie avec un taux d’occupation qualifié de “bon” ou “très bon” par 3 hôteliers sur 4 (VS un peu plus de la moitié l’été 2022). D’ailleurs, les professionnels croient aujourd’hui en un avenir positif, et même très positif ✨ (63 % actuellement contre 49 % cet été et 23 % l’été dernier).
Et l’envie de voyager encore et toujours se poursuit, comme en témoigne la fréquentation massive lors du Salon mondial du tourisme à Paris en mars dernier. Pour Marianne Chandernagor, la directrice de l’événement, il ne fait aucun doute que le revenge travel est encore d’actualité.
Pour autant, d’autres professionnels estiment que le phénomène s'essouffle. Après avoir cavalé pour tenter de rattraper le temps perdu, les touristes ne semblent plus vouloir pratiquer le voyage intensif. L’objectif tend désormais à se créer des souvenirs plus marquants, avec des expériences plus intentionnelles. On note d’ailleurs une nette augmentation des séjours de détente et de bien-être 🧘.
Quelques tendances qui se dessinent
Les professionnels notent quelques tendances qui font suite au phénomène de revenge travel, comme :
- voyager pour être au plus près de la nature
- la recherche d’authenticité et de diversité
- privilégier le bien-être (méditation, yoga, sylvothérapie, rajeunissement…)
- le bleisure et le nomadisme digital
- choisir une destination issue du cinéma et des séries.
Le revenge travel en 2025 : plus qu'une vengeance, une affirmation de soi
Ce phénomène a ouvert la voie à une nouvelle ère du tourisme. Les voyageurs sont plus que jamais conscients de l'impact de leurs choix et cherchent à concilier leur désir d'exploration avec la nécessité de préserver notre planète. Ce mouvement vers un tourisme plus responsable et durable est un signe encourageant pour l'avenir de l'industrie.
Les nouveaux moteurs du voyage :
- Incertitude globale : face à l'instabilité mondiale croissante, beaucoup ressentent l'urgence de découvrir des lieux et des cultures avant qu'il ne soit trop tard. L'idée de "voyager maintenant" prend de l'ampleur, motivée par la crainte de voir certaines destinations devenir inaccessibles à l'avenir. Les conflits géopolitiques, les changements climatiques et les restrictions de voyage font que les gens se sentent poussés à profiter de chaque opportunité pour explorer le monde 🌍 ;
- Durabilité et responsabilité : la conscience environnementale s'est renforcée. Les voyageurs sont de plus en plus soucieux de l'impact de leurs déplacements et recherchent des options durables et respectueuses des communautés locales. Les voyages éco-responsables, les hébergements verts et les activités de tourisme solidaire gagnent en popularité ;
- Expériences immersives : le tourisme de masse perd du terrain au profit d'expériences personnalisées et immersives. Les voyageurs veulent se connecter avec la culture locale, participer à des activités authentiques et créer des souvenirs durables. Les séjours linguistiques, les stages de cuisine locale et les visites guidées par des habitants sont particulièrement appréciés ;
- Bien-être et déconnexion : dans un monde hyperconnecté, le voyage devient une occasion de se déconnecter et de se recentrer sur soi. Les séjours axés sur le bien-être, la méditation et la nature connaissent un succès croissant. Les voyageurs cherchent à équilibrer leur vie numérique avec des moments de paix et de tranquillité.
La FAQ du revenge travel
Le terme "revenge travel" va au-delà de la simple reprise du tourisme. Il illustre une démarche émotionnelle où les voyageurs cherchent à compenser les restrictions imposées par la pandémie. Ce phénomène traduit une volonté de "se venger" du temps perdu en planifiant des voyages plus fréquents, plus extravagants ou plus mémorables, pour retrouver la liberté et les plaisirs suspendus pendant cette période difficile.
Le revenge travel modifie profondément les comportements des voyageurs. Ces derniers privilégient désormais des expériences uniques et authentiques, dépensent davantage pour des services personnalisés, et planifient leurs séjours longtemps à l'avance. On observe également une tendance à explorer des destinations moins connues et à rechercher une flexibilité accrue dans les réservations pour éviter les imprévus.
Les adeptes du revenge travel optent pour des activités qui procurent des souvenirs inoubliables : safaris, croisières de luxe, séjours dans des hôtels-boutiques, aventures comme la plongée sous-marine et les randonnées en haute montagne… Les expériences culturelles immersives et les escapades bien-être sont également très populaires.
Le revenge travel pose plusieurs défis aux professionnels du tourisme :
- Gérer une demande accrue tout en faisant face à des pénuries de personnel ;
- Répondre aux attentes élevées des clients en matière de personnalisation ;
- Intégrer des pratiques durables pour limiter l'impact environnemental.
Ils doivent également s'adapter à l'évolution rapide des priorités des voyageurs.
Le revenge travel a revitalisé l'industrie touristique mondiale, avec une augmentation significative des dépenses touristiques dépassant parfois la croissance du PIB. Il a permis de créer de nombreux emplois, de soutenir les économies locales et de stimuler la reprise dans les secteurs liés au voyage, comme l'hôtellerie et le transport aérien.